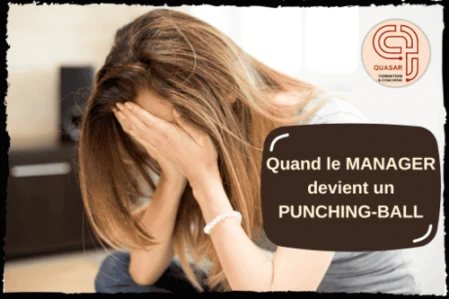
Publié le 1er octobre 2025 | Mis à jour le 4 décembre 2025
" Je suis leur punching-ball "
Élodie a lâché ça un mardi, 8 h 42, entre un café tiède et un e-mail intitulé "petite question rapide" qui, comme toujours, mesurait 2 pages et 19 sous-entendus. Elle n'a pas crié. Élodie ne crie pas. Élodie absorbe. C'est sa spécialité, son super-pouvoir et, accessoirement, son talon d'Achille. À trente ans, elle rêvait de faire grandir les gens. À quarante, elle murmure parfois à sa bouilloire : "et moi, qui me fait grandir ?"
Élodie est devenue manageuse parce qu'elle sait expliquer sans humilier, recadrer sans écraser, déléguer sans culpabiliser. Elle a lu des livres à couverture jaune, suivi des MOOC, collectionné des méthodes avec des acronymes rassurants. Elle croyait au contrat moral du management : je vous protège, vous jouez collectif. Or la promesse s'est délitée à la faveur d'une réorganisation, d'un budget raboté, d'un départ non remplacé. La charge n'a pas bougé d'un gramme. Et puis il y a eu Fabien.
Fabien, l'étincelle dans la poudre
Au début, Fabien faisait sourire. Voix du terrain autoproclamée, il avait l'art des punchlines qui décoiffent les réunions. Il n'était pas méchant, juste armé d'ironie et de certitudes. Il commença petit : un soupir appuyé quand Élodie rappelait un délai, un haussement d'épaules quand elle demandait de documenter une décision, un "on verra" lâché en rase campagne. Rien de spectaculaire, tout de répétitif. La Rochefoucauld aurait aimé -ah.. je me sens d'humeur vagabonde et vaguement littéraire à l'heure où je relate cette petite histoire (pardon d'avance ça risque de revenir)-, ce minimalisme stratégique : "Les petites actions qui se répètent font les grandes habitudes."
Puis la contagion. Fabien découvrit la puissance du chœur. Il testa les "CC" en rafale comme confettis de méfiance ; il s'adressa au N+2 "pour info" ; il transforma la messagerie instantanée en coulisses de théâtre. Deux autres collaborateurs se mirent à pratiquer le ghosting poli : on lit, on ne répond pas. Un troisième inaugurait la contradiction de principe : s'opposer d'abord, réfléchir ensuite. Les blagues tièdes sur "la cheffe" fleurirent, suivies de lapsus volontaires sur son prénom. Et puis on ne disait plus "Élodie décide", on disait "on nous impose".
Les faits, au quotidien, avaient l'allure anodine des micro-pluies qui trempent jusqu'à l'os : documents rendus sans la page 2 "parce qu'on est agiles", réunions envahies par des contre-ordres subliminaux, priorités renversées au nom du "bon sens opérationnel" dès qu'Élodie avait le dos tourné. Et lorsque celle-ci posait un cadre, on déplaçait le débat sur la forme : "ta façon de dire", "la rigidité", "la froideur des chiffres". Camus écrivait que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ; ici, on rebaptisait l'exigence en oppression et la clarté en contrôle.
Charlotte, la conscience qui s'abîme
Au milieu de cette nappe phréatique d'ironie, il y avait aussi une autre collaboratrice : Charlotte. Pas meneuse, pas suiveuse : poreuse. Elle a de la tenue, du sens du métier, et la fatigue qui va avec. Au début, les traits d'esprit de Fabien la soulageaient : enfin quelqu'un qui dit tout haut... Puis le soulagement s'est mué en malaise. Elle riait un peu, moins, plus du tout. Elle se surprenait à éviter Élodie dans le couloir, à retarder l'envoi d'un livrable "pour ne pas nourrir l'absurde". La culpabilité s'invitait, discrète. On appelle cela des ressentis négatifs cumulés : un mélange de honte légère, de loyauté flottante, de peur d'être isolée si l'on ne rit pas avec le groupe.
Charlotte s'est mise à douter de tout et d'elle surtout. Dissonance cognitive au petit déjeuner : elle voulait du cadre, exécrait la confusion, mais se taisait lorsque Fabien sabotait subtilement un rituel. Le soir, elle parlait de climat à la première personne du pluriel et d'attentes à la troisième. Elle sentait monter une irritabilité qu'elle ne s'expliquait pas ; une usure du respect, par frottement. " On se console souvent d'être malheureux par un certain plaisir qu'on trouve à le paraître ", glisserait encore La Rochefoucauld ; Charlotte, elle, ne trouvait plus ni plaisir ni consolation.
Ce qu'Élodie a enduré et tenté
Élodie a essayé, bien sûr. La pédagogie d'abord : elle a clarifié les rôles, ré-étalonné les priorités, raccourci les réunions, ramené l'oral au présentiel pour éviter les malentendus asynchrones. Elle a proposé des points individuels, des médiations, des formations. Elle a cadré, recadré, documenté. Elle a pris des notes, listé des faits, retiré les adjectifs. Puis elle a tenté la fermeté : rappels écrits, délais bornés, arbitrages explicites. Résultat ? La même pièce, acte après acte. Les objections changeaient de costume mais pas de texte. Les coalitions se faisaient et se défaisaient au rythme des urgences autoproclamées. Et Fabien, toujours au centre du manège, se posait en baromètre de "l'état réel du terrain".
La violence ici est feutrée. Pas de portes qui claquent, mais des respects qui s'effritent. Pas d'insultes, mais des insinuations. Pas de confrontations, mais des contournements. Élodie somatise. Elle dort mal, broie du noir clair, s'interroge sur sa compétence. Flaubert prévient : "on ne doit pas toucher aux idoles : la dorure en reste aux mains". L'idole du service s'appelle "culture sympa". On n'ose pas la gratter. On s'y coupe pourtant les doigts.
Anatomie d'une contagion
Du point de vue des "toxiques", le mot est trop gros pour leur miroir. Ils se vivent lanceurs d'alerte domestiques. Fabien se sent héroïque à peu de frais : il tient la posture, pas la preuve. Le groupe capitalise des frustrations légitimes - charge, outils, injonctions paradoxales - mais les redistribue mal. Les comportements se contaminent par capillarité : soupir, œil levé au ciel, blague, passif-agressivité, puis franc boycott d'un rituel. L'économie de l'équipe se dérègle. Ce qui ne coûte rien à l'instant coûte tout à la semaine : retards, re-travail, décisions émoussées.
Du point de vue de Charlotte, la tragédie est intime. Elle voit le bien-fondé d'une partie des critiques et l'instrumentalisation de l'autre. Elle sent son estime d'elle-même se griffer dès qu'elle se laisse happer par le chœur. Elle a peur de passer pour " vendue " si elle défend une décision, et peur de se renier si elle se tait. La solitude morale, ça ne fait pas de bruit ; ça use.
Du point de vue de la société, nous avons érigé la contradiction en hygiène démocratique du travail, c'est sain, mais nous avons oublié de la doter d'un mode d'emploi. Le numérique a démultiplié les scènes où jouer la comédie du dissentiment. Les interstices où se logent les malentendus se sont élargis ; la tirette "ironie" est devenue plus accessible que la manette "responsabilité".
Du point de vue de la hiérarchie, enfin, deux réflexes tiennent lieu de stratégie : le déni confortable ("tant que les chiffres tiennent") et la délégation infinie ("gère au plus près"). Dans les deux cas, on externalise le coût humain sur le premier niveau de management. Ce que l'on tolère devient la règle ; ce que l'on n'énonce pas s'impose.
Sortir du triangle : un accompagnement cadré et... un peu dur
Il ne s'agit pas de psychodramatiser. Il s'agit de re-contractualiser. Molière nous rappelle qu'il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger ; transposons : on travaille pour produire du sens et du résultat, pas pour produire du conflit. Ici, un accompagnement bref, structuré, focalisé sur les interactions qui font mal, a du sens. Le type même d'intervention qui mélange un travail préparatoire individuel, une confrontation cadrée et un suivi serré - ni thérapie de groupe, ni messe de réconciliation - mais un vrai protocole de gestion de conflit. Notre formation en gestion de conflit vous apporte les outils pour rétablir un cadre respectueux.
Concrètement, on commence par une cartographie froide des irritants : qui fait quoi, à quel moment, avec quel impact observable. On suspend les procès en intention, on revient au factuel. On audite les rituels : réunions, canaux, délais, priorités. On fixe quelques règles simples et non négociables : contradiction argumentée en séance plutôt que passif-agressivité asynchrone ; respect des délais et des champs de décision ; désescalade des "CC" inutiles ; droit pour Élodie d'interrompre une interaction dégradée et de basculer en face-à-face cadré. On décide aussi des conséquences visibles en cas d'écart, avec sponsoring explicite du N+2. Des acteurs externes spécialisés en gestion de conflit peuvent conduire cette séquence : préparation, séance de confrontation, puis point de suivi à 45 jours pour ancrer les engagements et mesurer les écarts. L'exercice est exigeant, parfois rugueux ; il est surtout efficace quand il est porté au bon niveau et adossé à des décisions.
Dans cette logique, Fabien n'est pas diabolisé ; il est responsabilisé. On sépare la valeur de ses alertes du mode de ses attaques. On redonne à Charlotte une place nette : contributrice qui peut contester sans se renier, soutenue lorsqu'elle choisit la voie adulte du désaccord loyal. On ré-arme Élodie : reformulations fermes, scripts de recadrage, usage des faits, tenue du cadre, escalade balisée - et surtout un sponsor hiérarchique qui co-porte la décision, tranche quand il le faut, protège quand c'est nécessaire.
Après la tempête, l'hygiène
Le succès n'est pas une chorale d'angélus. C'est une réunion qui finit à l'heure, un e-mail qui s'allège, une blague qui tombe à plat faute d'écho. C'est Fabien qui conteste sur le fond, en séance, sans détourner la scène. C'est Charlotte qui retrouve le droit de dire "je ne suis pas d'accord" sans se punir d'un sourire en coin. C'est Élodie qui cesse d'être un sac de sable pour redevenir manageuse, non parce que le monde a changé, mais parce que l'architecture des interactions a été refaite à neuf.
On ne cherche pas la paix sociale, on cherche la civilité professionnelle. Le conflit a sa place, l'attaque n'en a pas. Desproges disait qu'on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui ; au travail, on peut débattre de tout, mais pas à n'importe quel prix. Lorsque les irréductibles confondent liberté d'expression et liberté d'oppression, la hiérarchie a un devoir d'arbitrage, pas d'arrosage automatique de bienveillance.
Épilogue : le vendredi suivant, Fabien est passé voir Élodie pour dire, sans ironie, "c'était plus clair, merci". Charlotte, elle, a terminé son livrable et l'a envoyé sans se justifier. Élodie a souri. Pas par triomphe. Par hygiène. Parce qu'au fond, comme l'écrivait Camus, la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Ici, on a surtout retiré au présent ce qui l'empoisonnait.
© Quasar Lille
Découvrez d'autres articles sur le coaching et le management.